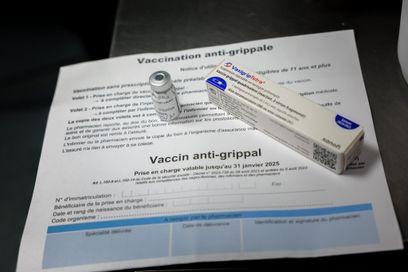« Quo nomine vis vocari ? » Telle est la question posée par le cardinal doyen du Sacré Collège au nouvel élu, juste après avoir obtenu de lui confirmation de son acceptation de la charge de pasteur universel de l’Église. Ce choix du nom, rappelant l’attribution par le Christ de celui de Pierre à son disciple Simon, est le premier acte du pontificat qui s’ouvre. Il met canoniquement fin à la période sede vacante du Saint-Siège.
Désormais, Pierre a un successeur : en ce sens, le pape ne meurt jamais, mais il prend un autre nom. La formule latine, « qui sibi nomen imposuit », qui suit la proclamation de l’habemus papam par le cardinal protodiacre, généralement couverte par la clameur de la foule s’élevant de la place Saint-Pierre, est plus parlante encore : le pape s’impose ce nouveau nom, emblématique de la charge qu’il s’est déterminé à assumer. Cet acte est inaugural, le nom (nomen) constituant une promesse autant qu’un présage (omen). Et ce nom, dont le choix s’opère sous le sceau du secret le plus impérieux du conclave, a dès lors vocation à être prononcé et répété sur toute la terre.
Au fil de l’histoire de la succession apostolique, plusieurs types de significations se sont attachés à ce choix et en ont accentué la solennité. Mais la pratique du changement de nom, assimilée à une forme de nouveau baptême et ayant émergé plus tôt lors de l’entrée dans un ordre religieux (certains papes issus du clergé régulier portèrent ainsi jusqu’à trois noms), ne se fixa que progressivement pour la papauté.
Le nom de Pierre
Le premier exemple semble être celui de Jean II (533-535), qui estima que son théophore de Mercure ne pouvait convenir à un chrétien. Après lui toutefois, la pratique ne fut pas suivie avant Serge IV (juillet-mai 1012), honteux de son nom initial (Pierre Os porci, soit « bouche de porc ») ou, selon l’argument avancé entre autres par le cardinal Baronius, par déférence envers le nom de Pierre, qu’aucun de ses successeurs ne saurait avoir l’orgueil d’adopter.
Tous les papes ultérieurs respectèrent cette règle, depuis Pierre de Pavie (devenu Jean XIV en 983) à Pietro Barbo (Paul II) jusqu’à Pierre-François Orsini (Benoît XIII) et allèrent jusqu’à influencer les choix opérés par les antipapes : l’Aragonais Pedro de Luna, dans les dernières années du XIVe siècle, se fit appeler Benoît. La prophétie des papes attribuée à saint Malachie, faux rédigé à la fin du XVIe siècle, attribue au pontife censé clôturer l’histoire terrestre de l’Église la devise de « Pierre Romain » (Petrus Romanus), refermant ainsi la succession apostolique. Cette forme d’interdit peut contribuer à expliquer que le nom de Jean ait été retenu par le plus grand nombre de papes, en référence au disciple préféré du Christ.
Un choix à caractère programmatique
Car le choix du nom pontifical, au-delà des spéculations douteuses et fantaisistes, recèle bien une dimension prophétique ; il met en jeu, selon le cas, des révérences au passé personnel de l’élu, éléments liés à sa famille, aux lieux fréquentés et aux figures rencontrées, parfois aussi à sa trajectoire ou « carrière » ecclésiastique, mais implique aussi, se tournant vers l’avenir, des références qui permettent d’augurer le caractère programmatique de ce choix et sa portée pastorale, politique et spirituelle.
Il peut souligner la volonté de la part du nouveau pape de s’inscrire dans une continuité et de souligner certains caractères dominants de tel ou tel pontificat précédent : ainsi agirent Grégoire XVI, se référant à Grégoire le Grand et à Grégoire XV (fondateur en 1622 de la congrégation de la Propagande, dirigeant l’action missionnaire de l’Église), ou Benoît XVI, en hommage à Benoît XV, pape de la paix durant la Grande Guerre, ainsi qu’à saint Benoît, proclamé saint patron de l’Europe par Paul VI en 1964. À elle seule, la « papauté des Pie » forme une séquence, quoique irrégulière, courant depuis Pie VI, lequel entendit rendre hommage à Pie V, applicateur rigoureux des orientations du concile de Trente, jusqu’à Eugenio Pacelli, élu en 1939 et qui prit le nom de Pie XII par reconnaissance envers Pie X qui l’avait nommé à ses premières fonctions au sein de la Curie (Pie X fut canonisé en 1954, précisément sous le pontificat de ce successeur reconnaissant) ainsi qu’à son prédécesseur direct, Pie XI, qui l’avait élevé à la dignité cardinalice et se l’était attaché en qualité de secrétaire d’État à partir de 1930.
Les signes des temps
Mais c’est Jean XXIII qui a laissé le témoignage le plus détaillé, et même argumenté, de son choix de nom : il s’agit du prénom de son père, Giovanni-Amleto Roncalli, du nom du saint patron de sa paroisse, du prénom de l’évêque de Bergame dont il fut le secrétaire et qui lui apprit à « penser grand », celui de l’apôtre préféré du Christ et, surtout, « un nom doux, un nom suave, un nom solennel, rappel ou invitation à aimer toujours, à aimer tout, à aimer en toutes circonstances, même quand la voix ou la plume ont le devoir de condamner ».
Le nom composé de Jean-Paul, choisi par le cardinal Luciani en 1978, récapitulait l’événement du concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII et clôturé par Paul VI. Le choix de celui de François par le cardinal jésuite Bergoglio n’étonna pas moins la chrétienté et le monde ; il exprimait d’emblée l’attention aux plus fragiles. Au moment du choix, la congruence de la mémoire du passé de l’Église et des défis qu’elle doit relever, ici et maintenant, fait de la décision du nouvel élu un acte qui excède sa seule volonté personnelle et vient alimenter en symboles et en concordances l’histoire d’une Église toujours attentive à déceler les « signes des temps » et ardente à les inscrire dans la mémoire des « Pierre » de Rome.